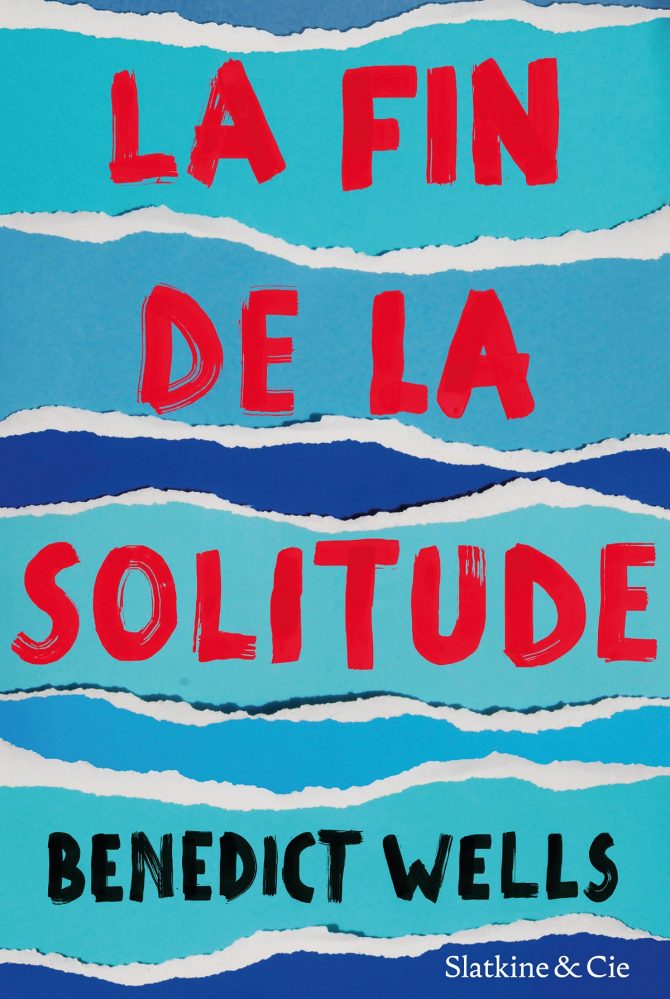Benedict Wells est le nouveau jeune prodige de la littérature allemande. Il est beau (ce qui n’a pas vraiment d’importance), il est brillant. Son histoire vous prendra au coeur, ses mots au ventre.
C’est un récit universel à la poésie réaliste, qui déroule les ressorts de la perte et de la reconstruction subséquente. Une démonstration viscérale que même ce qu’on croit acquis peut basculer – dans un sens ou dans l’autre – et que dans la plus cruelle des absences, on ne comble jamais que ses manques fondamentaux.
Dans ce roman moderne et incarné, le narrateur, dernier né d’une fratrie de trois enfants, se trouve séparé trop tôt de son frère et de sa soeur, suite à la disparition soudaine de leurs parents. Dispatchés aux différents étages d’un orphelinat – la hiérarchie s’applique par répartition architecturale, pour ces enfants sans fondations – ils se perdent alors qu’ils sont si proches. Plus tard, ce héros fissuré trouve l’amour, mais si c’était si simple, le livre ferait vingt pages. Ce qui serait un gâchis émotionnel incommensurable pour les lecteurs.
L’écriture est aussi lumineuse que le propos est sombre, et les éclaircies narratives réchauffent l’humeur de qui ne peux plus reposer ce bouquin envoûtant, puisqu’il parle du manque et du froid à l’âme, ce que chacun peut transposer à sa vie. Il est question des liens inextricables de la famille et de la force des liens du sang, y compris lorsqu’il est répandu.
Il faut lire La Fin de la Solitude parce qu’à un certain niveau, et bien après avoir refermé le roman, ce sera la fin de la vôtre.