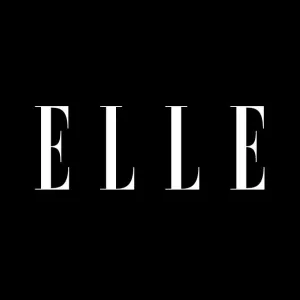En 1995, à Pékin, la conférence mondiale sur les femmes organisée par l’ONU posait les bases d’un programme ambitieux. Pourtant, 30 ans plus tard, le bilan est en demi-teinte. Selon le récent rapport de l’ONU Femmes, les droits des femmes ont reculé dans 1 pays sur 4 en 2024.
Ce rapport montre que de nombreux pays ont réalisé d’importantes avancées en matière d’égalité des sexes et d’autonomisation des femmes, allant de l’interdiction de la discrimination au travail à l’adoption de plans climatiques intégrant la dimension de genre.
Cependant, les inégalités persistent. « La discrimination fondée sur le genre demeure profondément enracinée dans les économies et les sociétés, imposant des contraintes persistantes sur les droits et les aspirations des femmes et des filles », alerte l’ONU.
L’affaiblissement des institutions démocratiques a contribué à freiner l’égalité entre les sexes, tandis que les nouvelles technologies et le changement climatique accentuent ces inégalités. L’organisation pointe notamment du doigt les réseaux sociaux et l’intelligence artificielle, qui « propagent des stéréotypes néfastes », ainsi que la fracture numérique entre les sexes, limitant l’accès des femmes aux opportunités.
Sur le plan professionnel, les écarts « stagnent depuis des décennies » : dans le monde, seules 63 % des femmes âgées de 25 à 54 ans occupent un emploi rémunéré, contre 92 % des hommes.
Dans le cadre des conflits armés, la situation est encore plus alarmante : au cours des dix dernières années, les violences sexuelles liées aux conflits ont augmenté de 50 %, 95 % des victimes étant des filles et des femmes.
Par ailleurs, dans 54 % des pays, la définition légale du viol ne prend toujours pas en compte le principe du consentement libre et éclairé. Globalement, une femme sur trois – soit environ 736 millions – a subi des violences physiques ou sexuelles au moins une fois dans sa vie. De plus, toutes les dix minutes, une femme ou une fille est tuée par un partenaire ou un membre de sa famille.
En d’autres termes, les droits des femmes sont loin d’être acquis et respectés. Si, en Occident, on a parfois l’impression de progresser, le combat est encore loin d’être terminé.
Si nous ne nous battons pas pour nous-mêmes, alors battons-nous pour les autres. Pour toutes celles qui font partie de ces pays qui ignorent les droits des femmes, pour toutes celles qui vivent dans ce quart de pays où leurs droits ont régressé, pour toutes celles qui pourraient être votre sœur, votre cousine, votre amie ou vous-même. Comment aurait été votre vie si vous étiez née ailleurs ?
Aux États-Unis
“Make America Great Again”, mais sans y inclure les femmes, apparemment. Avec un président comme Donald Trump, l’avenir des droits des femmes aux États-Unis est plus que préoccupant… Dès son retour au pouvoir, son administration a intensifié les mesures visant à restreindre l’accès à l’avortement (oui, encore). Elle a notamment annoncé son intention de se retirer d’une affaire défendant l’accès à l’avortement d’urgence et de soutenir une action en justice visant à supprimer le financement de Planned Parenthood, une organisation essentielle pour les services de santé reproductive.
Pour rappel, lors de son précédent mandat, Donald Trump avait nommé trois juges à la Cour suprême, faisant basculer la majorité du côté des conservateurs et conduisant à l’annulation de l’arrêt Roe v. Wade en 2022. Cette décision a rendu l’avortement quasi illégal dans de nombreux États, poussant des centaines de femmes à avorter de manière illégale, dans des conditions mettant leur vie en péril.
Tristement connu pour ses propos misogynes et masculinistes, accusé d’abus sexuels par plusieurs femmes et reconnu coupable dans certaines affaires, Donald Trump n’a que faire de la cause féministe et des droits des femmes. Bien qu’il maintienne vouloir “protéger” les femmes, qu’elles le souhaitent ou non (décidément, le consentement, ce n’est pas son dada), cela suscite de réelles inquiétudes quant à une régression (déjà en marche ?) des avancées en matière d’égalité des sexes aux États-Unis.
Avec des fervents défenseurs tels que Mark Zuckerberg, affirmant qu’il serait bon d’avoir “plus d’énergie masculine” au sein de ses entreprises, ou Elon Musk, accusé par plusieurs employées de les traiter comme des objets sexuels, on ne peut qu’avoir peur pour la place des femmes sur le marché du travail américain.
Et parce que notre bon vieux Donald Trump n’aime que les personnes dotées d’un sexe masculin, il a signé un décret exécutif stipulant que le gouvernement fédéral ne reconnaîtrait que deux genres : masculin et féminin, dès son arrivée au pouvoir en janvier. Cette politique a conduit à l’interdiction de modifier la mention du genre sur les passeports fédéraux, limitant ainsi les options pour les personnes non binaires ou transgenres souhaitant refléter leur identité de genre sur ces documents. Il a également interdit aux personnes transgenres de servir dans l’armée et a limité l’accès à certains soins médicaux liés à la transition.
Pour finir dans le listing des mauvaises décisions prises par Donald Trump — en moins de trois mois, rappelons-le — : son administration a procédé à d’importantes coupes budgétaires affectant les programmes d’aide extérieure, y compris ceux liés à la santé et aux droits des femmes à l’échelle internationale. Ces réductions ont soulevé des préoccupations quant à l’engagement des États-Unis — l’un des pays les plus influents sur l’échiquier mondial — en faveur de la promotion des droits des femmes dans le monde et l’image que de telles décisions renvoient à l’échelle mondiale.
En Afghanistan
Sous le régime des talibans, la régression des droits des femmes en Afghanistan a pris une tournure sans précédent cette dernière année… Malgré une pression internationale persistante, le gouvernement a renforcé ses politiques répressives envers les femmes sous couvert de faire respecter la charia, un dogme religieux et culturel radical.
En août 2024, une nouvelle loi a été promulguée à l’encontre des femmes, leur interdisant de s’exprimer publiquement et de participer à des manifestations ou activités culturelles, accentuant davantage leur marginalisation et les réduisant désormais au silence presque absolu. Si, en temps normal, toutes les formes de vie — y compris la faune — jouissent d’un droit à l’expression, comment peut-on concevoir de priver un être humain de ce droit fondamental ?
Parallèlement, l’accès à l’éducation, à l’emploi et aux soins de santé s’est considérablement réduit, rendant l’autonomisation des femmes pratiquement impossible. Des sources indiquent que le taux de scolarisation des filles aurait diminué de près de 40 % en une seule année, et l’accès aux services de santé essentiels pour les femmes aurait suivi une tendance similaire.
Ces mesures régressives témoignent de la volonté des talibans de revenir à une interprétation extrêmement rigide des normes sociales, menaçant de faire disparaître les maigres avancées obtenues ces dernières décennies.
En République démocratique du Congo
En 2024, la situation des droits des femmes en République démocratique du Congo demeure particulièrement préoccupante. D’après le Global Gender Gap Report 2024 du Forum économique mondial, la République démocratique du Congo se classe parmi les pays où l’écart entre les sexes est le plus marqué (140ième pays sur 146). La représentation des femmes dans les instances décisionnelles demeure quasi inexistante, traduisant des inégalités structurelles profondément ancrées.
Dans un contexte de conflit chronique et d’instabilité politique, les violences sexuelles continuent d’être utilisées comme arme de guerre et se multiplient avec une impunité trop souvent constatée.
Conjointement, le changement climatique vient exacerber ces difficultés. Dans de nombreuses régions rurales, les phénomènes climatiques extrêmes — inondations, sécheresses et déforestation — impactent durement l’agriculture, un secteur où les femmes jouent un rôle essentiel. Cette précarité environnementale aggrave l’insécurité alimentaire et renforce la vulnérabilité économique, limitant l’accès des femmes à des ressources indispensables, à l’éducation et aux soins de santé.
Face à ces défis, l’autonomisation des femmes se trouve encore davantage compromise, illustrant un cercle vicieux où les inégalités sociales et environnementales se renforcent mutuellement. Ces reculs, amplifiés par une désorganisation institutionnelle persistante, laissent peu d’espoir quant à l’amélioration de leur condition de vie…